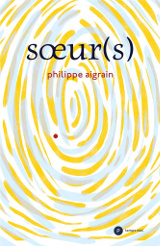La version courte c’est que ce livre est un petit bijou d’intelligence, de sens et de sensibilité dont il y a beaucoup à tirer et pour longtemps. Mais ce serait trop allusif d’en rester là. Ce petit livre dont le sous-titre est « Quand donc est-on chez soi ? » a été réédité chez Pluriel en 2015. Il était paru à l’origine en 2013 aux Éditions Autrement.
Après Loin de moi de Clément Rosset, c’est la deuxième fois que je fais une note de lecture sur un écrit philosophique dans ce blog dédié principalement à mes productions poétiques. Bien que très différents, les écrits philosophiques concernés labourent le terrain où germe la poésie. Leur écriture en est d’ailleurs comme envahie. Le premier chapitre de La Nostalgie, que je vous laisse découvrir, est tout entier un texte poétique, et pas seulement parce qu’il cite des poèmes, ou parce que pour comprendre et transmettre des émotions qui sont sans doute trop fortes pour pouvoir être directement décrites, la poésie est un passage nécessaire. Il faut à Barbara Cassin dire qu’on est « hospité » pour introduire l’une des thèses fondamentales du livre qui est que l’on est chez soi et toujours de façon fragile, là où on est reconnu, accueilli… même si on n’y est… pas (chez soi) au sens du lieu et encore moins du peuple de naissance.
Mais La Nostalgie n’est pas un livre autour d’une seule idée. Pas le genre de la dame, ou plus précisément pas celui de la philosophie. Et pour dérouler les idées qui viennent chacune enrichir et complexifier (mais pas compliquer) les précédentes, elle nous promène dans trois récits, celui d’Ulysse dans l’Odyssée, celui d’Énée dans l’Éneide et celui d’Hannah Arendt en elle-même. L’Ulysse d’Homère nous fait partir d’un premier sens de la nostalgie, le mal du pays, le retour, si long, si difficile. Ce retour qui montre aussi que le mal du pays est aussi le mal de l’ailleurs, qui nous y entraîne ou nous y retient. C’est ce récit qui nous révèle le rôle de la reconnaissance (par son fils, son chien, la nourrice et celle qui compte, sa femme), après que l’introduction nous ait fait partager celui de l’accueil. On est donc chez soi lorsqu’on est reconnu et par là accueilli. Mais on n’est pas au bout, et là c’est Ulysse après l’Odyssée partant au bout du monde (connu des grecs) pour y planter une racine en terre totalement étrangère (là où on ne connait rien de la mer ni même des barques) et pouvoir ainsi enfin vraiment revenir là où il avait construit ses racines. Énée, lui, fuyant Troie, ne connaîtra pas le retour mais l’exil fondateur. Barbara Cassin n’est pas seulement philosophe, elle est aussi philologue, et c’est progressivement dans la langue, les langues, l’entre-les-langues qu’elle nous amène. Car Énée fondant Rome doit parler une autre langue, mais une langue bien différente du grec conçu comme langue d’un peuple et entouré de barbares. Là Énée doit parler le latin, la langue de l’autre qui n’est pas la langue des romains, mais la langue de tous les citoyens. Il doit aussi parler « plus d’une langue ».
C’est avec Hannah Arendt que le rôle de la langue dans l’être chez soi se dévoile pleinement dans le livre. Car la doublement exilée ne peut se penser que dans la langue maternelle et non dans la patrie. La langue maternelle, celle où la poésie est possible, est celle qui l’accueille. Mais là aussi à condition de ne pas s’y confiner. Il faut d’autres langues, il faut la traduction, l’entre les langues et ses tours. On n’est chez soi qu’à condition d’être aussi chez les autres, de les accueillir en soi. C’est dans cette partie que j’ai compris pourquoi le livre me touchait tant, car dans la poésie ce sont les liens multiples et ambigus des mots dans la langue, qui parlent en nous, et qui, peut-être, après beaucoup de labeur, permettent de parler aux autres et dire un peu ce que Barbara Cassin appelle « la chancelante équivocité du monde ». Mais cette poésie serait orpheline si elle ne vivait pas aussi d’autres langues, des traductions et des jeux entre les langues.
Le propos de Barbara Cassin est profondément politique. Toute ressemblance avec ce qui nous révolte, nous émeut ou nous porte à agir depuis qu’elle a écrit le livre ne relèverait d’aucune coïncidence mais bien de la pertinence visionnaire de son propos. Nous perdrons notre chez soi si nous ne savons pas y accueillir les exilés, nous perdrons notre langue si nous laissons les clichés administratifs l’envahir, la langue ne devenir plus qu’une propagande :
De fait, c’est parce qu’on a une responsabilité à l’égard des mots qu’on emploie, une responsabilité d’auteur et non de récepteur ou de passeur communicant, que la langue est aussi chose politique.
Je vous laisse découvrir la conclusion du livre comme son introduction. Mais je ne peux terminer cette note sans évoquer un souvenir personnel. J’ai rencontré plusieurs fois Barbara Cassin dans le contexte du Forum d’Action Modernités. Lors de l’une de ces rencontres, l’auteur présentait son livre Google-moi au groupe de réflexion sur les technologies du forum que j’animais avec Daniel Kaplan. Ce fut une discussion difficile, où chacun restait dans son domaine de pensée, les technologues reprochant à la philosophe de ne pas avoir compris la substance de ce que fait Google en prenant au mot les mots de Google et la philosophe insistant – déjà – sur le fait que ces mots sont importants et tout autant de les pourfendre. Nous avions tous raison. Mais je regrette que nous n’ayons pas su alors dépasser l’écart qui nous séparait. Nous aurions pu « penser avec l’autre ». Il n’est pas trop tard.