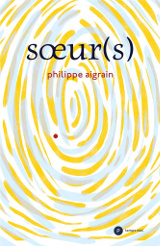Il y a des notes de lecture qui doivent commencer par se situer, non pas par rapport à l’auteure, mais pour expliciter d’où on lit son livre. Nous vivons une époque où des penseurs très divers repensent les relations entre les humains d’une part et les animaux, les plantes, la nature en général, mais aussi certains éléments culturels comme la mémoire des disparus, les esprits qui paraissent habiter le monde dans certaines cultures. Cette reconsidération me paraît être hautement salutaire parce qu’en replaçant les êtres humains dans des réseaux de relations avec leur environnement, elle s’affronte à la mégalomanie et au réductionnisme qui jettent une humanité qui se croirait maîtresse de l’univers dans les pires exactions, y compris à son propre égard. Je me suis notamment passionné pour les approches de courants contemporains de l’anthropologie comme le perspectivisme d’Eduardo Viveiros de Castro et l’école de Philippe Descola, avec une mention spéciale des travaux de Nastassja Martin. Ces travaux portent à l’origine sur des civilisations de chasseurs-cueilleurs, de l’Amazonie à la Sibérie et l’Arctique, civilisations souvent dites animistes, parce qu’elles considèrent les animaux et plus généralement les êtres visibles et invisibles dont ils se sentent entourés comme des personnes, et même, pensent que les animaux eux-mêmes nous pensent comme une sorte particulière d’animaux. Alors que les chasseurs-cueilleurs considèrent les animaux domestiques comme privés de leur âme, en comparaison des animaux sauvages, des théories semblables ont aussi émergé pour analyser les rapports de civilisations d’éleveurs aux animaux qu’ils élèvent, puis même les rapports des humains contemporains aux animaux domestiques. Les auteurs concernés prêtent une attention particulière aux perspectives sur le monde que procure le fait d’avoir un corps, qu’il soit de chat ou de vache, d’humain ou même d’arbre. Ou plutôt à ce que nous humains pouvons imaginer que sont ces perspectives. Cela crée, selon moi, une affinité particulière entre ces penseurs et la phénoménologie d’un Merleau-Ponty. Et tous sont traversés d’un curieux rapport à la littérature, qui les fascine, qu’ils ne peuvent parfois pas se retenir de pratiquer, mais dont ils se sentent forcés de s’écarter pour satisfaire aux règles de leurs disciplines.
Ce qui rend le livre Mort d’un cheval dans les bras de sa mère de Jane Sautière si important, outre la beauté et l’économie de son écriture, c’est qu’elle fait le chemin en sens inverse, et armée de l’attention au détail, de l’empathie et du scrupule à tout écart à la vérité sentie et au souci éthique, elle nous offre une anthropologie domestique et urbaine sans pareille. Il y a d’abord, mais aussi au bout du compte, l’attention à l’animal en nous sans nier ce qui nous en sépare et la responsabilité qui en résulte, ici s’adressant aux animaux :
Je n’ai pas de cris, de vocalises, de hululements lorsque je me mets sous le ciel, plus rien de cela. J’ai les mots, les mots du trismus de ma mâchoire d’animal, sous la lune blanche, le reflet pur, seul, sans rien d’autre, le reflet sans origine. La beauté finalement, en lieu et place, le don de déclarer la beauté en lieu et place. Et la responsabilité de la faire advenir. Et il me semble que vous m’y aidez.
Mais venons-en aux animaux domestiques et en particulier aux chats qui occupent une place sans pareille dans le livre et semble-t-il dans la vie de son auteure. Le chat est l’animal privilégié de nombreuses approches littéraires car sa domestication laisse – presque – toujours en lui une part de liberté qu’on dirait sauvage. Ce qui fait dire à Jane Sautière de la petite, qui persiste à vouloir s’échapper et y parvient :
Rendre compte par le langage de la vastitude de leur monde que la domestication rogne est bien périlleux. Je vais échouer. Je vais laisser vierge cet espace là où je n’ai pas à être, où je célèbre par la joie de voir la petite chercher son chemin, se captiver, se méfier, chasser. Cet animal libre et pourtant domestiqué. Elle a tout déjoué. J’espère qu’elle triomphera des embûches de sa vie propre, sa vie d’animal, et aussi de celles si nombreuses que notre emprise sur le monde rajoute. Aucune liberté gratuite, aucune liberté qui ne se paye, ressasse l’humain. Et pourtant, elle le dément, la petite.
Mais quel est donc notre devoir à l’égard des bêtes et en particulier celles que nous avons domestiquées, sculptées et régies en tout, de la reproduction à l’alimentation, de l’usage que nous en faisons à l’espace que nous leur concédons :
À la puissance, nous devions inférer la protection. C’était un dû, un devoir. Nous sommes en deça de nous mêmes pour vous, bêtes animales et pour vous, humains animalisés. L’indignité des puissants nous tient tous serrés dans le même troupeau.
Même les nuisibles, rats et cafards par exemple, n’échappent pas à la réflexion de l’auteure. Mais c’est autour de la question de la viande en ce temps où nous avons presque totalement perdu la symétrie qu’induisait la symétrie de la chasse chez les chasseurs-cueilleurs qui parfois se faisaient tuer par les animaux chassés. Il fallait un grand livre pour définir ce que peut être notre devoir à l’égard des animaux dans cette situation, sans aucune mièvrerie. Le paysan qui tue son cochon, l’éleveur qui affronte le cri de bébé du chevreau qu’il va tuer ou même l’auteure qui plonge un crabe dans l’eau bouillante sont plus proches du chasseur-cueilleur que celui qui consomme des poissons parallélépipédiques ou des blancs de poulet sans carcasse.
Il y a aussi dans ce livre foule de purs joyaux de littérature, notamment dans le bestiaire qui le conclut. Je vous en livre deux d’ailleurs dans le livre. Dans le premier, l’enfantement d’une bête mort-née rejoint la disparition d’une œuvre :
La mort d’une œuvre est incompréhensible, irréalisable.
et dans le second la perception d’un son animal ténu renvoie à l’amour humain :
Ce ne sont pas les petites choses qui font le moins de bruit, le choc dur d’une pétale sur une table un soir de grand amour me l’avait déjà appris, l’oreille se déplie, le son gagne la force à laquelle il doit être hissé, la merveille prend sa place durable.
Mort d’un cheval dans les bras de sa mère de Jeanne Sautière est paru dans la collection Verticales des Éditions Gallimard, en février 2018.