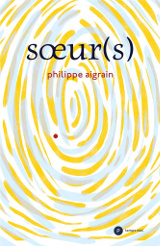Il y avait un handicap au départ. En général, je n’aime pas les livres à propos de peintres ou de musiciens. Enfin c’est ce que je croyais avant le Séraphine de Françoise Cloarec (découvert d’abord à travers son adaptation cinématographique) et Charlotte de David Foenkinos. Ce n’était pas une réticence à ce que les images ou la musique parlent « en texte ». Juste une incertitude sur la possibilité de mêler le récit d’une vie et cette parole « en texte » des œuvres. Mais ce livre là, je savais que je pourrais y entrer par un autre chemin, par la langue.
J’ai donc commencé à lire Louis sous la terre en mode « mais comment elle fait ». Cela commence par les phrases courtes, ciselées, rythmées par la répétition d’assonances, des « ras » de la deuxième personne du futur par exemple. J’ai goûté les mots avant de prêter attention à leur sens profond. La longue liste des Louis et de leurs attributs en forme de noms propres. Par moments, la prose versifiée avec un point au bout de chaque ligne, la même formule que dans le Charlotte déjà mentionné, et pourtant un effet complètement différent, sans doute parce que l’on passe vite des phrases brèves à des lambeaux de phrase, un seul mot parfois. Plus loin, des phrases qui courent tout au long d’un grand paragraphe, avec un seul souffle, comme si les phrases courtes s’étaient branchées les unes sur les autres se communiquant à chacune leur énergie, une langue qui est une sorte de fluide. En fait, il faut le dire, j’étais un peu écœuré de tant de facilité, beau imaginer que plein de transpiration derrière, quand même au bout du compte la facilité pour le lecteur. Je me suis même raconté que c’était trop bien, qu’il faudrait des aspérités, des fautes quelque part, excuse pour celui qui ne saurait pas faire sans. Le sens profond a commencé à me rattraper, l’idée que les troubles de vision précoces de Louis Soutter (plus tard diagnostiqués, mais est-on sûr, comme sclérose de la choroïde) étaient une sorte de matrice du texte, une invitation à un regard intense et fragmentaire. J’ai commencé à naviguer entre sens et écriture.
Et puis il est venu un moment, je sais précisément lequel parce qu’il y a une tache de thé renversé sur le livre à cet endroit, où le texte m’a emporté. Cela commence par :
Ainsi tu marches. Tu dis des noms de lieux qui existent, des cols qui ne me disent rien, ni la distance, ni le paysage, vallée ou plaine, colline ou lac, ni la forme des chemins parcourus, sentes imprécises ou chemins empierrés, landes sauvages, hauteur des arbres, obstination des taillis, tu sors et tu marches et tu prends un chemin, un autre, et tu marches comme un cheval tire, régulièrement, l’encolure basse, martelant le sol sans regarder au-delà…
Et puis, il y a un autre endroit, je ne vous dirai pas où. On s’y rend compte que ce n’est pas un livre sur un artiste, ni sur une personne prise dans un enfermement d’autant plus terrible qu’il n’est pas directement brutal mais tout de même sans recours malgré tant de tentatives. Précisément parce que c’est tout cela, c’est un livre sur chacun de nous. Alors les œuvres qui se mettent à parler si bien dans leur infinie difficulté à exister, elles sont le message de ce qui en chacun de nous est enfermé, mais qui par des pores invisibles et avec des efforts sans fin parvient tout de même à sourdre. Me reste alors la fin de vie de Robert Walser, lui aussi enfermé pendant des décennies et qui lui aussi marcha dans la neige.